A l’angle des rues Czaki et Mickewicz
L’appartement est sombre, silencieux. Il fait froid. Le tic-tac de l’horloge de la cuisine meuble la solitude d’Alice. Elle est assise à la table du salon, penchée sur son ouvrage. C’est le début de l’hiver, une lumière blanche éclaire la table. Alice a ouvert les rideaux pour laisser passer les rares rayons de soleil. Elle n’a pas envie d’être éclairée par ces ampoules électriques fraichement installées.
– Nie, nie chcę …
– Je t’en prie Amélia, parle français. Comment veux-tu qu’Alice fasse des progrès à l’école, si tu t’obstines à parler en polonais ?
– Je suis polonaise, je n’aime pas parler français. Et puis, je ne veux pas de ton électrécité !
– Electricité, Maman, on dit électricité !
– Je m’en moque, je ne veux pas de vos ampoules. Cette lumière me donne mal à la tête et puis c’est dangereux. Alice est trop jeune, elle va attraper du courant dans les mains. Elle pourrait en mourir.
– Mais Mamo, je ne suis plus une enfant. L’électricité c’est l’avenir …
– Oh toi, tu es toujours prête à défendre ton père, comme si il était le roi de Pologne.
– Grâce à cette nouvelle installation, je verrais mieux le soir pour travailler. Je pourrais fabriquer plus de chapeaux.
– Le soir, tu n’es jamais là, toujours inviter dans tes soirées mondaines. C’est encore là bas que tu as trouvé cette idée de faire installer ton électrécité !
Alice, toute à ses souvenirs, travaille à la décoration d’un chapeau d’une forme très originale. Un chapeau cloche. Sur la table, se mêlent perles, plumes et fils de soie. Quelques paillettes apportent de petits éclats de lumière dorée. Ce désordre chamarré contraste avec le silence austère de la pièce.
– Alice tourne-toi avec plus d’élégance, arrête-toi juste au bord du podium. Oui comme ça, mets ta main sur la hanche et penche toi légèrement sur le côté. Très bien ! Allez un petit clin d’œil, oui, tu es la plus belle, tu dois les avoir tous à tes pieds à la sortie du défilé …
Alice porte une robe en lin, simple, ample et légère. Sans corset. Alice se sent libre. Son père Stan la dirige pour le prochain défilé de mode qui aura lieu dans moins de deux jours. A son cou, un long collier de perles et de breloques scintille. Elle s’amuse comme une enfant. Tous les yeux sont tournés vers elle. Elle sera la reine. Des yeux, elle jubile.
Au loin Paul Hustin, le dernier couturier embauché par Stan admire Alice. Son cœur se débat entre la bienséance et le désir de l’enlacer. Voilà à peine six mois qu’il est arrivé pour créer une nouvelle ligne de couture. De l’audace, de la liberté avait demandé le père d’Alice. Au cours des derniers essayages, la main de Paul avait effleuré la taille d’Alice, ses doigts touché sa nuque. Il avait senti son corps frémir, lorsque lestement il la faisait tourner pour vérifier l’aplomb du tissu. Il y a des regards qui ne trompent pas. Oui il en était certain, si le défilé était une réussite, il demanderait sa main.
Sous les ovations et les grains de riz, Paul et Alice sortent de l’église, enlacés. Tout deux vêtus de blanc. Paul portant un chapeau confectionné de la main de Stan Ambrosi, Alice vêtue d’une robe perlée de dentelles à la taille très basse créée par Paul. La maison « Hustin et Ambrosi » venait de sceller sa première alliance. Dans les cheveux d’Alice, une myriade de plumes blanches et prunes.
Alice cherche à installer une plume légèrement tachetée de couleur prune, sur le côté du chapeau cloche, gris souris. Elle a pris le temps de coudre avec soin, quelques perles pour former une arabesque. Elle place la plume à droite, à gauche, au centre de l’arabesque, rien n’y fait. Elle n’est pas satisfaite de son travail.
– Je ne veux pas que tu partes !
– Ma douce, je n’ai pas envie de partir non plus. Nous avons tout fait, avec ton père pour m’éviter les tranchées. Il a usé de toutes ses relations. J’ai travaillé aux ateliers de couture du Ministère de la Guerre. Mais aujourd’hui c’est inévitable. Ils manquent de bras. Ils disent que c’est presque fini. Le gouvernement américain envoie des hommes. Ce ne sera plus très long.
– Paul, j’ai peur. N’y vas pas, cache toi …
Malgré tout Paul était parti, embarqué dans cette mauvaise guerre. La vie était devenue difficile. La nourriture manquait, le charbon, le froid perdurait. Et puis les étoffes de tissus avaient disparues également, tout allait à l’effort de guerre. Nourrir et vêtir les soldats, produire encore plus d’armes. Il n’y avait rien d’autres à faire. Un matin gris, le facteur lui avait apporté cette lettre du Ministère. Elle s’était effondrée dans les bras de sa mère.
Agacée, Alice jette son ouvrage sur le bord du fauteuil près de la fenêtre, quand la sonnette tinte à la porte d’entrée. Elle n’attend personne à cette heure de l’après midi. Elle se lève et sans bruit se rapproche de la porte, pour regarder dans l’œilleton.
Ensuite, tout avait été très vite. Des milliers de soldats américains avaient débarqué. Depuis quatre ans, Paris n’avait jamais compté autant d’hommes aussi jeunes, les poches remplies de chocolats et de « chewing-gum ». Alice hébétée par la douleur, le deuil, multipliait les rencontres. Son bonheur passé sombrait avec le vin qui coulait à flots. Les américains en raffolaient, chez eux l’alcool était interdit. La mort à portée de main, la vie exultait. Le combat entre vie et mort se menait là aussi, avant les tranchées, dans les chambres et les alcôves.
Le matin de l’armistice, Paris était en liesse. La paix signée, la vie reprenait ses droits. Alice, à genoux devant une bassine, vomissait. Sa poitrine avait gonflée, la vie s’annonçait là aussi, en elle.
Alice à travers l’œilleton, entrevoit sa mère, une lettre à la main et une femme inconnue se tenant droite, attendant qu’elle ouvre la porte. C’était la faiseuse d’anges. Elle venait détricoter la vie qui germait en elle. Sa mère, Amélia, avait tout de suite compris ses nausées. Son père l’avait mis sur le compte du chocolat et du vin, si difficile à digérer après ces dernières années de restriction. Amélia voulait garder l’enfant. A la naissance d’Alice, la fièvre puerpérale lui avait interdit d’en avoir d’autres. Alice, elle, ne se sentait pas capable d’élever un enfant, seule, sans père. Elle voulait effacer d’un coup d’aiguille le résultat de la vie décousue qu’elle avait menée ces derniers mois. L’opération était risquée, mais son choix était fait.
Pendant que les deux femmes préparaient bassins et serviettes, elle ouvrit la lettre que sa mère lui avait tendue à son arrivée.
Alice, ma douce,
J’espère que cette lettre n’arrive pas trop tard. Je t’attends à partir du 19 novembre vers minuit, au Maria Hôtel à Varsovie, à l’angle des rues Czaki et Mickewicz. Rejoins moi au plus vite, je t’en prie.
Ton Paul.

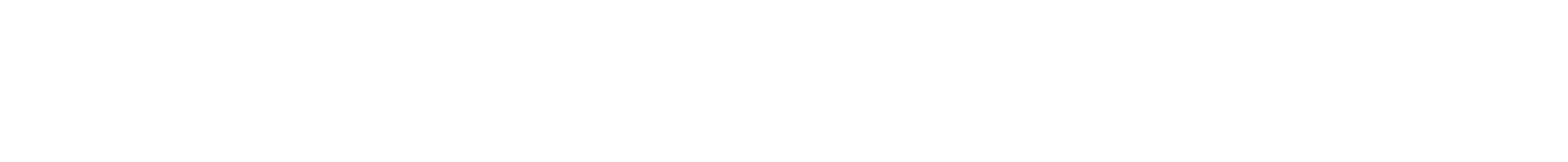

0 commentaires