Ma chère cousine,
Je viens de recevoir votre lettre sous pli confidentiel et me voici transporté quarante ans en arrière, à Combray, chez Tante Léonie, la cousine de notre grand-père – notre grand-tante – chez qui nous passions l’été, en vacances loin du mauvais air parisien qui m’apportait son lot de douleurs ; mon corps traversé par les crises d’asthme, souffrait tant du manque d’air que je faillis en mourir à l’âge de neuf ans.
Nous rentrions de bonne heure de notre promenade dominicale pour rendre visite à mon oncle – votre père – avant de diner. Il y avait là notre voisin, Mr Legrandin, ingénieur de métier et artiste-poète de cœur, grand, le visage pensif, arborant de longues moustaches blondes, le regard bleu transparent, trahissant le désenchantement, aimable causeur – il était au yeux de notre grand-mère, qui le citait toujours en exemple, le type d’homme raffiné qu’elle aurait aimé rencontrer à son plus bel âge.
Votre mère nous avait surpris en nous photographiant sans en annoncer son intention – nous portions tous les trois ces étranges blouses des jours communs, ceux sans paillettes ni apparats, où nous savions par avance qu’aucun invité de prestige ne se présenterait au risque de se montrer trop impoli. Votre mère, à la vue de mon visage contrarié, le cerne de mes paupières noircissant, reconnaissait elle-même après avoir appuyé sur le déclencheur de l’appareil photographique que nos tenues toutes simples n’étaient guère celles d’enfants de nobles naissances – elles n’étaient pas digne d’être couchées sur le papier glacé que l’on trouve chez ce photographe, du côté de Guermantes.
Lorsque votre mère me fit la promesse de ne faire aucun tirage de ce cliché impromptu, je couvris de baisers fous ses joues roses de me voir si reconnaissant et tandis qu’avec assez d’embarras, vous me laissiez entendre, vous ma cousine, sans oser me le dire ouvertement, que vous aimeriez garder le souvenir de nos portraits en blouse d’écolier, je vous disais, les larmes aux yeux, que le souvenir de cette photographie serait en moi si odieux que je trouverais bien un jour le moyen de vous témoigner mon courroux.
Voilà votre mère morte depuis moins d’un mois et vous déliez sa promesse faite en ce lointain dimanche d’été, vous vous précipitez comme ces prestidigitateurs qu’on aperçoit intacts et en redingote dans la poussière d’un coup de feu d’où s’envole une colombe, de cet éclat apparaît cette épreuve oubliée, extrait du fond de votre mémoire. Vous aviez mis en réserve votre souffrance, celle de vous venger de moi, alors que d’aucun ne connaissait notre filiation, vous auriez aimé en montrer la preuve photographique.
Vous souhaitiez vengeance, la flèche que vous venez de m’envoyer sous pli a atteint une autre cible que celle que vous aviez visée, dans votre aveugle empressement. A me retrouver le temps imperceptible d’un regard, à Combray, dans ce jardin apprivoisé au fil des longues promenades en compagnie de Tante Léonie, à revoir l’ombre moustachue de ce cher Mr Legrandin, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Nous le savons tous, en théorie du moins, la terre tourne, mais en fait on ne s’en aperçoit pas, le sol sur lequel on marche semble ne pas bouger et on vit tranquille. Il en est ainsi du Temps dans la vie. Et pour rendre sa fuite sensible, les romanciers sont obligés, en accélérant follement les battements de l’aiguille, de faire franchir au lecteur dix, vingt, trente ans, en deux minutes.
Par votre lettre et le cliché photographique qui l’accompagne, vous m’avez donné à vivre cette sensation réelle et vertigineuse du temps qui passe. Vous voilà bien meilleure romancière que moi, peu de mots, quelques ombres sur un papier jauni par le temps ont suffi à me transporter. Grâce à vous j’ai à nouveau tressailli … à la recherche du temps perdu.
Je vous remercie avec effusion.
Votre cousin, Marcel.

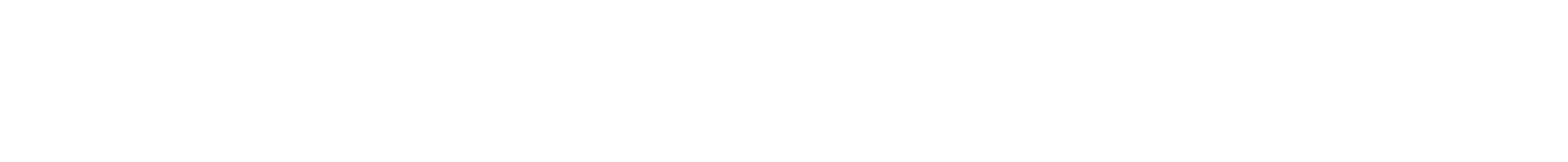


0 commentaires