Aujourd’hui, 13 janvier 1898, est une date à marquer d’une pierre rouge. Je dois écrire à Lucien. Il sera soufflé. Quelle histoire et surtout quel culot. J’accuse ! Il n’a peur de rien l’Emile.
Pourtant, ce matin, j’étais en proie au doute, à l’incertitude. Une mauvaise habitude qui me tient trop à cœur. Depuis mon lit, je songeais, de fil en aiguille, d’une touche de couleur à l’autre, je me portais, d’une bien curieuse façon, dans le bureau d’Emile, le grand Emile Zola, juste devant la cheminée. Sur le linteau, j’avais le souvenir de ces lettres gravées dans la pierre « Nulla dies sine linea ».
À coup sûr, ce n’était pas sans raison qu’il avait fait graver ce proverbe, sur sa cheminée, en plein devant son bureau. De ces lignes à tracer, chaque jour, lignes de mots ou traits de couleur, je me devais d’en suivre le chemin. Je me levais donc, le cœur plus hardi, décidé à peindre une nouvelle variation de l’avenue de l’Opéra.
La matinée était belle pour un jour de janvier. Froide et sèche. La neige des dernières semaines avait totalement fondu. Les rayons lumineux réchauffaient le pavé gris. Quelques passants matinaux s’attardaient pour profiter de cette chaleur inattendue.
C’était donc avec un nouvel œil que je redécouvrais l’avenue de l’Opéra. Je fredonnais, tandis que mes mains crayonnaient de mémoire, le tracé de la grande avenue. J’en connaissais les moindres détails, les masses des immeubles haussmannien, les verticales, et surtout la perspective, vers où tout converge, l’Opéra, le point d’orgue du tableau, donnant l’illusion de la profondeur. Le regard porté sur la toile, j’en oubliais le sujet même de mon étude, l’effervescence, le brouhaha de la foule, le rythme des sabots frappant pavé, les noires calèches aux destinations empressées.
Le ciel était d’un bleu glacé, les pierres d’un rose tendre, les arbres dépouillés. Une journée magnifique pour reproduire l’esprit hivernal parisien.

Et pourtant quelque chose me chagrinait. De trop nombreuses tâches noires assombrissaient le tableau. Pourquoi tant d’agitation sur les trottoirs ? Sur la place, des berlines arrêtées faisaient signe aux crieurs de journaux. Des queues de pie et des chapeaux haut-de-forme s’agglutinaient aux vendeurs. Je le voyais bien, je l’entendais même … quelque chose d’inhabituelle se déroulait sous mes yeux. Un appel répété à l’envi, s’invitait à mes oreilles. « J’accuse, la lettre ouverte de Zola au Président Faure, demandez l’Aurore ! J’accuse … ». Tous s’arrachaient les feuillets du quotidien, je devais connaître la raison de cette agitation. Je demandais au liftier de m’apporter le journal.
J’ai lu puis relu, plusieurs fois, la lettre de Zola. Je restais bouleversé et surtout admiratif de la force de conviction d’Emile. Quel talent, quelle ferveur aussi ! Le plus grand impressionniste, à mon sens, j’en étais certain. J’avais lu tous les Rougon-Maquart, tous ses mots, toutes ses phrases, comme autant de variations, par petites touches, sur un même thème : la vie des hommes de notre temps. Il était le plus fort, le plus audacieux. Il donnait l’envie de se surpasser. Moi aussi, je voulais peindre le mouvement de la vie.
Sans attendre, je reprenais mes pinceaux. C’est à ce moment là, je crois, que les rayons du soleil ont illuminé la place du Théâtre français, dans une grande oblique, comme une possible ouverture vers un avenir, autre, plus juste, plus serein. Grâce à Zola, moi aussi j’osais !
Camille P.

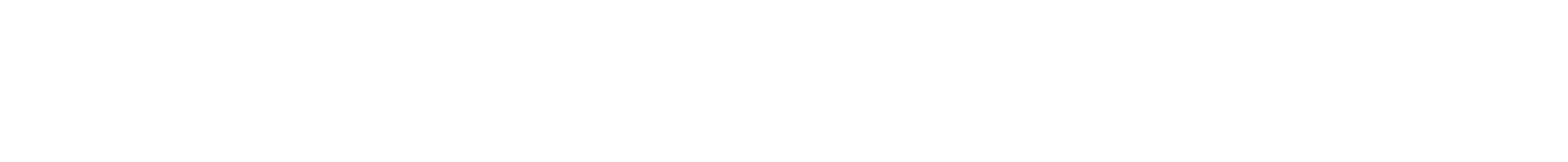

0 commentaires