Suivre l’éclat de rire
Vous savez, il y a des moments comme ça, dans votre vie où tout va bien, vous êtes amoureux de votre femme comme au premier jour, vous vous sentez vraiment bien. C’est à ce moment là que vous devez vous mettre à écrire une tragédie. A l’inverse, quand vous vous sentez misérable, que tout est épouvantable, inconfortable alors vous devez écrire une comédie.
Je me sentais mal à cette époque, il y avait eu la prise de pouvoir de Bush contre Al Gore en 2000. Puis, ensuite le 11 septembre. Ce jour là j’étais à Brooklyn, dans la rue les gens marchaient, protégeant leur visage avec leur manteau. Toute la poussière, les débris arrivaient de Manhattan, portés par le vent. J’avais le sentiment de vivre dans une autre Amérique, une Amérique volée par Bush, qui n’aurait jamais dû subir cette attaque. Quelques mois plus tard, pour sortir de ce marasme, je me suis dit que c’était le moment d’écrire un livre drôle. C’est ce que j’ai fait.
J’avais entendu parler de cette curieuse histoire où une jeune journaliste avait trouvé une lettre de Stefan Zweig dans les replis du divan de Sigmund Freud.
L’idée m’avait amusée. J’avais même ri en imaginant cette jeune femme allongée sur le divan freudien au nez et à la barbe du personnel du Freud Museum. Elle avait publié un article dans le New York Times. C’est là que j’ai lu la lettre et le début de la nouvelle inachevée de Stefan Zweig.
A bien y réfléchir. Je me sentais proche de Zweig à cette époque là de ma vie. Lui aussi, avait été malmené par la politique. Bien plus encore que moi. Mais je sentais que sa détresse faisait écho à la mienne. Et puis, il y avait eu cet éclat de rire, à la lecture de l’article du New York Times. Je devais suivre cet éclat, l’écriture de la comédie commençait par là.
J’ai commencé l’écriture du récit, en m’inspirant de la nouvelle inachevée. J’ai développé l’histoire jusqu’à nos jours. La nouvelle se construit comme une pièce de musique. Une fugue à plusieurs voix qui entrent et qui se taisent laissant la place à d’autres voix. Tout le livre marche comme ça. C’est une réflexion. sur la guerre, les générations d’hommes qui partent se battre. Mais aussi sur la famille, les répétitions à travers les liens familiaux. Les femmes qui malgré elles, fabriquent des hommes qui partent sur les champs de bataille.
Le thème n’est pas véritablement comique, mais c’est plus la façon dont je l’ai traité qui le rend amusant. Mais peut-être le mieux serait que je vous lise les deux premières pages. Vous pourrez ainsi vous faire une meilleure idée du ton et de l’histoire.
Les racines du passé
J’étais dans un avion pour Paris, installé au fond d’un siège inconfortable, avec la lettre sur mes genoux, à la lire plusieurs fois de bout en bout. Elle comptait plus de dix pages, écrite d’une main fiévreuse, la calligraphie était ronde, nerveuse dans la ponctuation et les barres aux t. Si j’avais nourri le moindre doute quant à mes origines obscures, la lettre de ma mère, Irina Hustin, les dissipa.
Elle était née à Paris en 1946, juste après la fin de la guerre. Elle avait été élevée par sa mère Clémentine Hustin et n’avait jamais connu son père qui était mort au combat, elle l’avait toujours entendu dire de la bouche de sa mère. Irina avait eu une enfance heureuse malgré l’absence de ce père manquant, sa mère ne s’était pas mariée, elle s’était dévouée pour lui offrir une vie paisible et cultivée. Clémentine avait voulu que sa fille soit une femme libre et indépendante, elle lui avait offert la meilleure éducation jusqu’au jour où elle avait découvert au sein, une tumeur envahissante.
L’écriture d’Irina devenait, avec l’annonce de la maladie de sa mère, comme torturée, les mots raturés et les tâches d’encre rendaient la lecture difficile. Mais j’y arrivais. Petit à petit, je crois que j’en déchiffrai l’essentiel et chaque fois que je décryptais un nouveau paragraphe, les racines de mon passé prenaient forme au dessus de l’océan que je traversais à la recherche de mes origines.
J’avais été un enfant de Woodstock, conçu dans l’euphorie de l’émancipation sexuelle et de la révolte de mes parents contre le carcan de l’après-guerre.
Bien qu’ils furent les premiers à manifester leur désir de non-violence, en prônant « Faites l’amour, pas la guerre », mon père fût envoyé au Viêt-Nam, pour y mourir sous les bombes. Je n’avais aucun souvenir de mon père, il était mort trois semaines avant ma naissance, le choc de sa disparition avait précipité mon arrivée. Irina avait passé les six mois suivants à se regarder s’enliser dans l’alcool et la drogue, oubliant mes pleurs et mes cris, si les services médicaux n’avaient pas été alertés par une voisine bienveillante, je serais mort de faim.

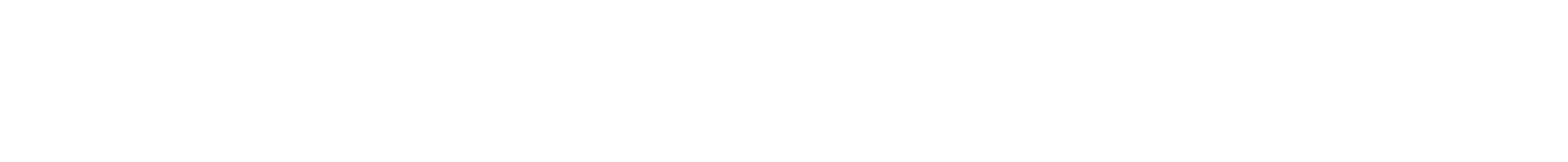


0 commentaires